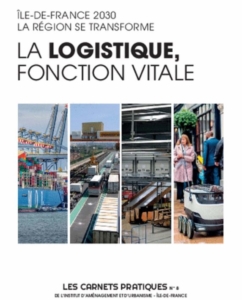L’avant-projet de loi d’orientation des mobilités vient d’être transmis au Conseil d’Etat. Logicités s’est procuré ce projet et l’a analysé, pour les sujets concernant la mobilité des marchandises.
Le titre 1 de cette loi « AMÉLIORER LA GOUVERNANCE DES MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES » intègre de nombreuses modifications de textes légaux, touchant essentiellement à la mobilité des personnes. Un élément, certes non contraignant, est une modification d’un article du code de l’urbanisme permettant aux collectivités locales de « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la réalisation d’équipements logistique est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif ».
Le titre 2 « REUSSIR LA REVOLUTION NUMERIQUE DANS LES MOBILITES » a pour objectif d’encourager les innovations en matière de mobilité, de favoriser les expérimentations et réguler les nouvelles formes de mobilité. Une disposition importante prévue dans ce projet concerne la possibilité pour les collectivités locales de réserver certaines voies ou certaines portions de voies communales, de façon temporaire ou permanente, à diverses catégories d’usagers, de véhicules ou à certaines modalités de transport. Cette disposition ouvrirait ainsi des perspectives à un meilleur partage de la voirie.
Le titre 3 « DEVELOPPER LES MOBILITES PROPRES ET ACTIVES » parle essentiellement d’un sujet important, consistant à réserver des espaces de stationnement vélo lors des aménagements et projets immobiliers. L’article 22 mentionne le changement de vocabulaire. Nous ne parlerons plus de Zone à Circulation Restreinte mais de Zone à Faibles Emissions. Ces zones deviennent obligatoires lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière.
C’est dans le titre de 4 de cette loi, « SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES » qu’apparaissent diverses mesures visant à améliorer la compétitivité du transport maritime, fluvial et ferroviaire. Il est notamment prévu que « L’Etat peut instaurer un dispositif visant à prendre en charge une part des coûts de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire par des opérateurs de service de transport de fret, permettant de favoriser ce mode de transport par rapport à d’autres modes qui présentent des externalités négatives plus importantes, tel que le transport routier de marchandises ».
Bien sûr, cette analyse reste partielle et le document n’est que provisoire. Le document disponible ne prévoit en tout cas que bien peu d’éléments concernant la logistique urbaine et, s’il s’agit du document complet, les professionnels qui se sont engagés dans les assises de la mobilité ne peuvent être qu’un peu déçus. Peut-être y a-t-il une autre version du document ou d’autres chapitres de cette loi qui ne sont pas encore apparus.
Alors attendons la suite de cette loi tant attendue, qui doit théoriquement intégrer des dispositions fortes concernant la logistique urbaine.