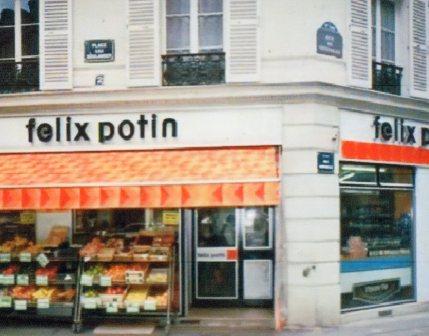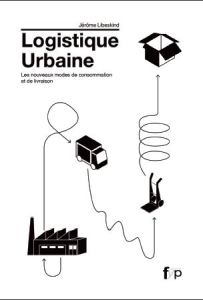Élément incontournable du B to C ou du C to C, le colis constitue le dénominateur commun de la logistique.
Vendre un produit sur internet est simple. L’expédier est une toute autre aventure.
Le marchand, ou le particulier, confie son produit à un réseau industriel de transport. Ce colis va être manutentionné de nombreuses fois. Une fois lors de l’enlèvement. Une autre fois dans une agence départ, souvent dans un hub plus ou moins automatisé. Puis dans une agence de distribution, parfois dans un point relais ou un bureau de poste, et de multiples fois en cas de double ou triple présentation, en cas de retour ou de mise en souffrance.
Les transporteurs ont fait de nombreux efforts pour améliorer le soin qu’ils apportent à la manutention des colis. Nous avons pourtant tous en tête des images de colis écrasés, égarés, détériorés lors des opérations de transport.
Le soin qu’apporte l’e-marchand à bien tenir son entrepôt, à protéger ses produits, est parfois mis à mal dans la chaîne de transport, qui achemine ce produit dans un circuit de transferts multiples.
L’e-marchand, dans de nombreux cas et notamment lorsqu’il s’agit de produits fragiles, prend alors des précautions. Il choisit un carton de grande dimension, multiplie les calages à l’intérieur, avec papier froissé, film bulle, coussin d’air et autres ingéniosités permettant de protéger le produit vendu et faire en sorte que son client reçoive le produit dans de bonnes conditions. Le vendeur particulier va lui aussi utiliser tous les moyens à sa disposition, papier journal, polystyrène, carton, etc.
L’emballage est donc un problème en soi. A tel point que certaines start-ups, à l’instar de Shyp aux Etats-Unis, se sont spécialisées sur ce créneau d’emballage et d’expédition pour le compte d’e-marchands.
L’emballage, bien connu dans l’industrie, est un métier. Bien protéger le produit, mais aussi éviter les calages et cartons surdimensionnés, qui multiplient les coûts, les volumes transportés et augmente l’impact environnemental de la supply chain, constitue un enjeu majeur.
Quels sont les bons et les mauvais élèves ?
Les bons élèves sont certainement les e-marchands qui disposent de formeuses et machines d’emballage permettant le réglage du carton en fonction de la hauteur du produit. Ce réglage permet de supprimer, sauf pour des produits très fragiles, le calage intérieur et réduit le volume transporté. Il ne réduit pas de beaucoup le carton consommé, le carton étant généralement replié ou découpé. Ces machines ont été acquises par plusieurs e-marchands et prestataires, disposant de gros volumes d’expédition.
Cette réduction du volume transporté permet aussi de mieux négocier ses contrats de transport.
Le transport en enveloppes plastiques est adapté à des produits peu fragiles (vêtements par exemple) mais reste peu adapté dès lors que le produit ou l’emballage de vente présente un risque de fragilité.
De nombreux e-marchands, même parmi les plus grands, A..…, utilisent pour une part importante des colis préparés des cartons traditionnels avec calage. Ceci induit un surdimensionnement considérable, mais aussi un coût environnemental et un volume inutile transporté qui n’est probablement pas calculé à sa juste mesure.
Un autre e-marchand, Happyview, spécialiste de la vente de lunettes sur internet, est certainement un des meilleurs exemples d’étude optimisée de l’emballage. L’étui à lunettes est conditionné sans calage dans un carton de seulement 16 cm x 8 cm x 8 cm, parfaitement adapté à la plupart des étuis à lunettes et qui entre facilement dans une boîte aux lettre. Les documents (ordonnance, facture, publicité) sont utilisés pour caler l’étui dans son carton. Pas de calage, un carton parfaitement optimisé, nous sommes dans une situation parfaitement maîtrisée et optimisée.
L’optimisation de l’emballage présente de nombreux avantages. L’e-marchand réduit son coût d’achat d’emballages et supprime le coût de calage. Le temps de préparation de commandes est réduit. Le colis rentrant dans de nombreuses boîtes aux lettres, l’échec à la livraison est également diminué. Le faible volume des colis permet de mieux négocier ses prix de transport. Enfin, l’impact environnemental du colis individuel est réduit.
La situation d’un étui à lunettes standardisée est probablement plus simple à gérer que le conditionnement de produits alimentaires, de décoration, de design ou d’électronique. Cet exemple montre cependant que la gestion parfaite du conditionnement d’expédition permet d’optimiser la supply chain du dernier kilomètre.