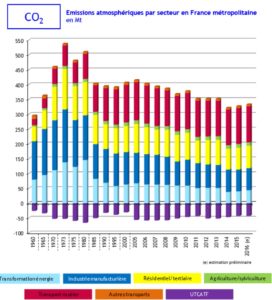La loi relative à la transition énergétique prévoit dans son article 40 une disposition qui incite la mise en œuvre de solutions permettant d’augmenter le taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.

Evidemment, les professionnels peuvent s’étonner de l’intérêt d’une loi pour inciter le transporteur à tout simplement faire son métier, qui consiste à optimiser ses moyens de transport.
Le sujet est en fait beaucoup plus large et complexe. Il touche à la réduction de la part la moins optimisée du transport, le transport effectué par des non-professionnels.
Il s’agit d’abord du transport effectué par les particuliers. Le déplacement effectué par un particulier qui va faire ses courses dans un hypermarché est moins productif que la livraison à domicile. En effet, le particulier va effectuer un trajet Aller/Retour spécifique, en général à vide à l’aller, et avec un coffre de voiture plein au retour. Un professionnel de la livraison à domicile va effectuer des livraisons en tournées, avec un parcours optimisé. L’occupation de la voirie et l’impact environnemental sera dans ce cas inférieur.
Mais la partie la plus problématique est liée au taux de professionnalisation. Une différence significative entre la France et l’Allemagne. En France, le nombre de Véhicules Utilitaires Légers (VUL) est 10 fois supérieur au nombre de véhicules Poids Lourds (PL). En Allemagne, ce ratio n’est que de 1 à 2. Les véhicules Poids Lourds sont plus gros, donc logiquement moins nombreux et utilisés prioritairement par des professionnels du transport ou des flottes internes (Compte Propre expéditeur). L’utilisation plus importante de véhicules de type porteur participe à une utilisation plus efficace de l’espace public.
La partie la moins optimisée de la logistique urbaine est le compte propre destinataire, l’artisan qui a son propre VUL. Il a, comme les particuliers lors de leurs achats au supermarché, un véhicule pas toujours bien occupé, roulant en partie à vide.
Un des enjeux de la Logistique Urbaine est par conséquent d’aider à une réduction de cette part du compte propre. Il s’agit là d’une tendance de fond. Le taux de professionnalisation a déjà augmenté lors des 10 ou 20 dernières années mais reste encore insuffisant dans de nombreux secteurs. Réduire le nombre de véhicules dans une agglomération passe nécessairement par la réduction de la part du compte propre destinataire.
Il serait donc judicieux que les aides à l’acquisition de véhicules propres profitent en priorité aux professionnels du transport et pas nécessairement aux artisans, dont le transport n’est pas le cœur de métier.
Une meilleure efficacité de la ville passe par une plus grande professionnalisation des flottes de véhicules, qui permettront alors d’en réduire le nombre, peut-être d’augmenter la taille de ces véhicules, en tout cas d’augmenter le taux de remplissage des camions. Certains pays, comme le Japon vont encore plus loin dans cette démarche en imposant un seuil minimum de nombre de véhicules pour un transporteur professionnel. Là encore, un transporteur qui a 10 véhicules parviendra à mieux optimiser ses tournées que s’il n’a qu’un seul véhicule.